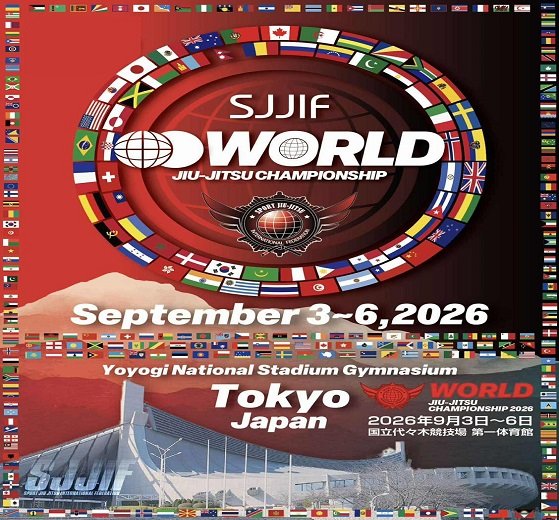Témara, ville tranquille de prime abord, se retrouve depuis deux semaines sous les projecteurs, secouée par une affaire judiciaire aux allures de déséquilibre flagrant : un représentant de l’autorité, protégé par un certificat médical de trente jours, est absent du tribunal, tandis qu’une jeune femme fait face à des accusations sérieuses… seule face à l’institution.
L’affaire, désormais surnommée « dossier du caïd de Témara », met en cause quatre personnes, dont une jeune femme, Chaïmae, poursuivie pour « outrage à un fonctionnaire en exercice ». Le fonctionnaire en question – un caïd – n’était pas présent à l’audience, justifiant son absence par une « période de repos » médicalement prescrite, non pas pour une incapacité physique, mais pour des troubles psychologiques consécutifs à une altercation en public.
Une justice à deux vitesses ?
La défense du caïd insiste : il ne s’agit pas d’une blessure invalidante, mais d’un choc émotionnel, une « dépression » causée par un affrontement verbal avec une femme, dans un « contexte social masculin ». Ce glissement de la plainte vers une souffrance psychique interroge. La justice peut-elle, dans une société encore patriarcale, considérer les troubles mentaux d’un homme d’autorité comme plus graves que les douleurs physiques présumées d’une jeune femme accusée ?
De son côté, la défense de Chaïmae ne reste pas silencieuse : elle demande non seulement l’exclusion des certificats médicaux produits par les représentants de l’État (le caïd et un membre des forces auxiliaires), mais exige aussi que sa cliente soit examinée par une gynécologue, et non une généraliste, après avoir déclaré avoir subi un saignement. La question qui se pose ici est simple : la justice écoute-t-elle vraiment toutes les souffrances de la même manière ?
“قائد تحت الحماية… ومواطنة تحت المساءلة: تمارة تحاكم امرأة وتُعفي رجل السلطة بشهادة!”
Quand l’opinion publique dérange
Autre point de tension soulevé : le rôle de l’opinion publique. Les avocats du caïd dénoncent une tentative d’influencer le cours de la justice en « se prévalant de l’émotion populaire ». Pourtant, cette même opinion pourrait être le seul contrepoids à une mécanique judiciaire qui, parfois, semble dérailler.
L’absence du caïd, le rejet des demandes de délais supplémentaires par le tribunal malgré les éléments sensibles en jeu, et l’insistance à vouloir clore le dossier rapidement, posent la question d’un jugement sous pression. Est-ce la volonté d’éteindre rapidement une affaire embarrassante ? Ou bien une tentative de préserver une certaine image de l’autorité publique ?
Une affaire révélatrice
Au fond, ce procès dépasse le cas individuel de Chaïmae ou du caïd. Il révèle une tension plus profonde : celle entre une jeunesse marocaine de plus en plus consciente de ses droits, de ses blessures, et une administration qui peine encore à se réformer dans ses pratiques et son regard.
Dans ce duel judiciaire inégal, où une femme fait face à la machine administrative, le Maroc est appelé à se regarder dans le miroir de sa justice. La question n’est plus seulement : qui dit vrai ? Mais : à qui la justice choisit-elle de croire, de protéger, ou de sacrifier ?